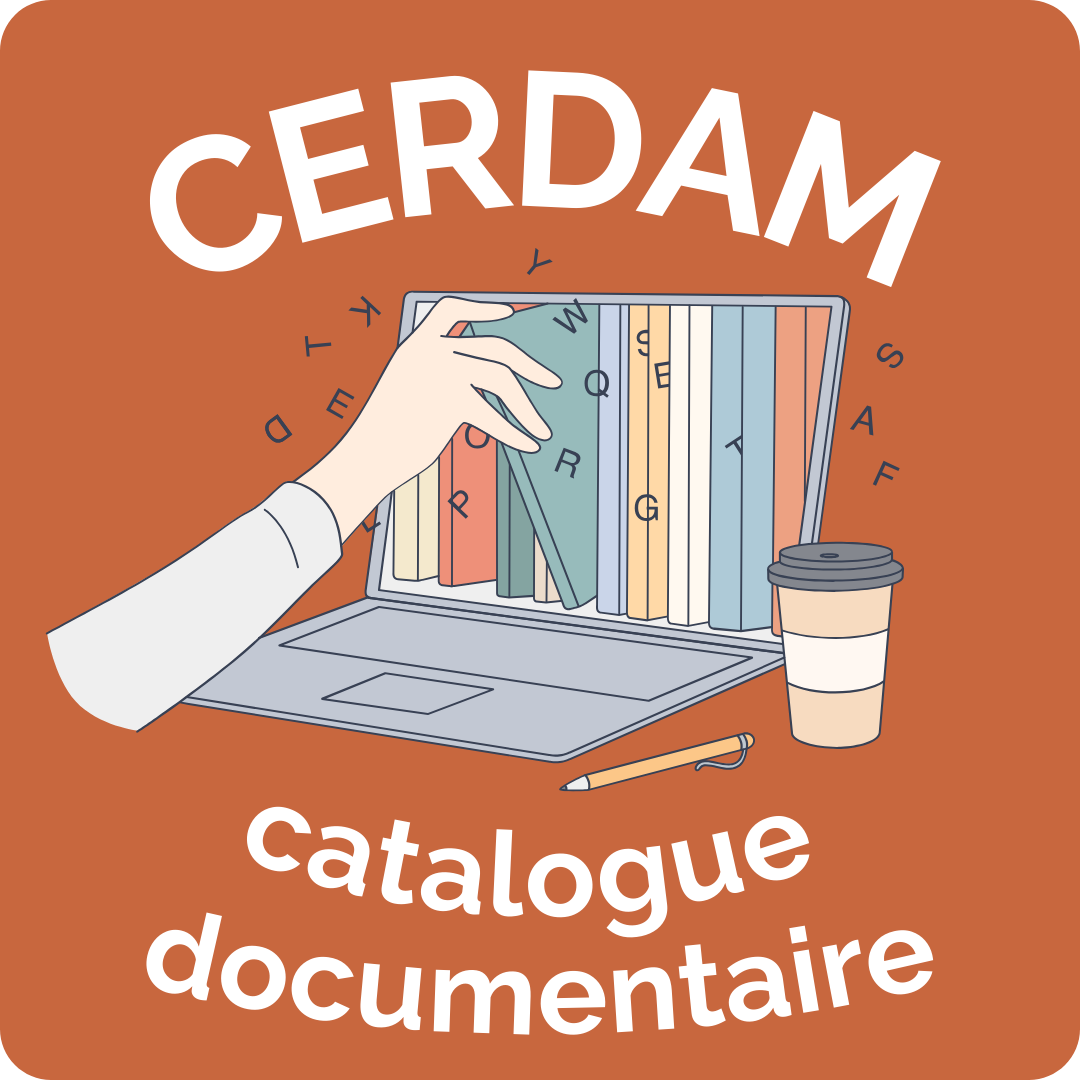Les caractéristiques et vécus des femmes présentant une production lactée faible : entre complexité physiologique et charge émotionnelle
Cette étude australienne menée par Manshanden et ses collègues a pour objectif de mieux comprendre les caractéristiques et les expériences vécues par les femmes dont la production lactée mesurée sur 24 heures était inférieure à la normale. Alors que la perception d’un “manque de lait” est l’une des principales raisons d’arrêt précoce de l’allaitement, peu de recherches avaient jusqu’ici objectivement comparé les situations de faible et de normale production de lait chez les mères allaitantes.
Les chercheur·se·s ont analysé les données de 136 femmes ayant mesuré leur production de lait sur 24 heures entre un et six mois après la naissance, à l’aide de pesées avant et après chaque tétée et expression. Une production inférieure à 600 mL en 24 heures a été considérée comme faible, tandis qu’une production égale ou supérieure à ce seuil a été classée comme normale. Ces mesures objectives ont été complétées par un questionnaire en ligne explorant les antécédents médicaux, les facteurs de risque de lactation et le vécu de l’allaitement, y compris les perceptions subjectives du manque de lait.
Les résultats montrent qu’environ 29 % des participantes présentaient une production lactée faible, un taux plus élevé que ce que la littérature suggérait jusqu’ici. Les femmes de ce groupe partageaient certaines caractéristiques communes : la présence de seins hypoplasiques (13 % contre 3 % dans le groupe à production normale) et une plus grande fréquence d’utilisation de préparations commerciales pour nourrissons. Malgré un poids de naissance comparable, les bébés des mères à faible production présentaient des scores poids-pour-âge significativement plus bas, confirmant que la production lactée influence directement la croissance infantile.
Fait intéressant, les perceptions subjectives ne correspondaient pas toujours aux mesures objectives : 21 % des femmes ayant une faible production pensaient produire assez de lait, tandis que 28 % de celles ayant une production normale croyaient manquer de lait. Cette discordance illustre combien les représentations et les inquiétudes maternelles autour du “manque de lait” sont influencées par des facteurs autres que la physiologie — tels que la confiance en soi, la lecture des signaux du bébé ou les messages reçus du corps médical et de l’entourage.
Les analyses qualitatives donnent un éclairage précieux sur le vécu des femmes concernées. Beaucoup ont décrit le stress, la culpabilité et l’épuisement liés aux tentatives répétées pour augmenter leur lactation, souvent à travers des régimes intensifs de tétées, de tirages et de compléments. Plusieurs participantes ont mentionné avoir passé des centaines d’heures à pomper, souvent au détriment de leur sommeil et de leur santé mentale. D’autres ont exprimé leur frustration face à des conseils professionnels jugés contradictoires ou culpabilisants. Certaines regrettent d’avoir tardé à consulter une consultante en lactation, tandis que d’autres estiment avoir reçu des recommandations inadaptées, notamment la restriction des tétées ou la réduction du peau-à-peau.
Pour les stratégies de gestion du faible volume de lait, le recours à un tire-lait électrique hospitalier s’est révélé être l’intervention la plus jugée utile, suivi du “triple feeding”, qui combine allaitement, expression et complément. [Le « triple feeding » est une routine selon laquelle on va enchaîner toutes les 3 heures une tétée, une séance de tire-lait et un complément de lait maternel ou de lait artificiel à administrer au bébé.]
Cependant, cette approche a été vécue comme extrêmement exigeante, chronophage et source d’épuisement. Les galactagogues non pharmacologiques, tels que les gateaux de lactation ou les plantes, ont été jugés peu efficaces, tandis que la dompéridone, lorsqu’elle était utilisée, a souvent été perçue comme aidante — même si les auteurs rappellent la nécessité d’une prudence médicale et d’un suivi attentif (voire article IPA : https://info-allaitement.org/ressources-en-ligne/prescription-de-domperidone-dans-le-cadre-de-lallaitement-quels-benefices-et-quels-risques-en-2023/).
Les femmes ont unanimement souligné l’importance du soutien relationnel : la présence du ou de la partenaire, de la famille et des consultantes en lactation a été décrite comme déterminante pour leur persévérance et leur bien-être émotionnel. Beaucoup ont déclaré que la reconnaissance de leurs difficultés et le réconfort reçus auprès d’une professionnelle de l’allaitement avaient été plus bénéfiques que les interventions techniques elles-mêmes.
Les auteures concluent que la faible production lactée, mesurée ou perçue, est à la fois fréquente et multifactorielle. Les causes peuvent être physiologiques — comme une hypoplasie mammaire, un trouble endocrinien ou un antécédent de chirurgie — mais elles peuvent aussi être liées à des pratiques d’allaitement, à un manque de soutien ou à des conseils inadaptés. Plus de la moitié des participantes concernées n’avaient jamais reçu d’explication médicale claire quant à leur faible production, révélant un vide dans l’évaluation clinique et la communication avec les familles.
Cette étude rappelle ainsi que le “manque de lait” n’est pas toujours explicable ni réversible, et qu’il appelle une approche individualisée, bienveillante et informée. Elle souligne aussi la nécessité de développer des outils cliniques fiables pour mesurer la lactation et guider les décisions, tout en renforçant la formation des soignant·e·s à la physiologie de la production lactée et à l’accompagnement émotionnel des parents.
Référence
Mots clés : allaitement, baisse d'allaitement, pratique professionnelle, production lactée, stress

 Pack dépliants
Pack dépliants